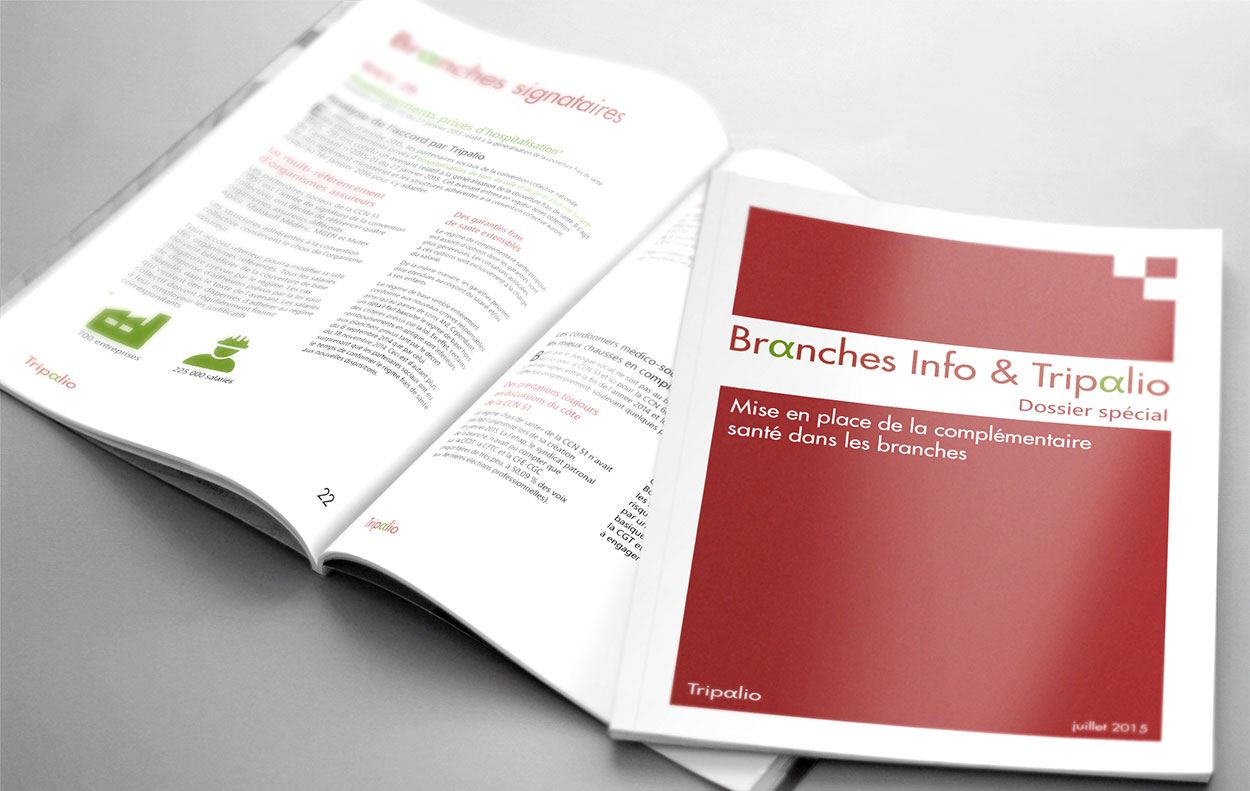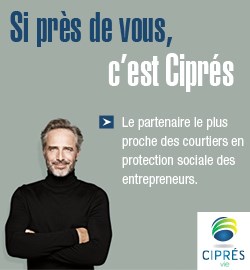Cette décision ravirait, bien évidemment, un certain nombre d’intermédiaires, puisqu’elle mettrait immédiatement entre parenthèses les quelques 65 désignations existantes. Elle ruinerait du même coup les positions défendues par un certain nombre d’institutions de prévoyance, pour qui les désignations déjà actées étaient gravées dans le marbre ad vitam aeternam.
Mais pourquoi appelle-t-on cette jurisprudence «néo-calédonienne»? Un petit rappel juridique s’impose.
Le Conseil Constitutionnel fut inventé par le Général De Gaulle en 1958, avec la cinquième République. Cette innovation mérite d’être remarquée: elle créait une autorité, un corps constitué comme on dit (c’est-à-dire un corps dont l’existence est mentionnée dans la Constitution), susceptible de limiter la loi et son contenu. Or, en France, depuis 1789, existe le dogme selon lequel «la loi peut tout». Inventer une sorte de tribunal capable de censurer une loi votée par le Parlement était donc un bouleversement en profondeur.
Longtemps, le Conseil Constitutionnel est resté dans l’ombre et a fait une interprétation très restrictive des prérogatives qui lui étaient reconnues. C’est pourquoi il se limitait volontiers aux questions qui lui étaient posées, auxquelles il répondait sans véritable audace.
En 1971, avec la jurisprudence «contrats d’association», c’est-à-dire trois ans après le départ du général De Gaulle, le Conseil Constitutionnel marque une première émancipation, en contrôlant la conformité des lois non seulement avec la Constitution, mais aussi avec les «principes fondamentaux reconnus par les lois de la République».
En 1985, avec la jurisprudence néo-calédonienne, le Conseil marque une deuxième étape dans son affirmation: il s’autorise à déborder des simples réponses aux questions qui lui sont posées, en statuant sur des lois déjà adoptées par le passé, c’est-à-dire sur des lois promulguées, alors que la Constitution ne lui reconnaît pas explicitement ce pouvoir.
Cette jurisprudence provient de la décision du 25 janvier 1985, sur l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie. A cette époque, des députés de l’opposition avaient saisi le Conseil en mettant en cause une loi votée et en attente de promulgation, mais en mettant également en cause une loi adoptée quatre mois plus tôt sur le même sujet. Le Conseil avait alors considéré que «la régularité au regard de la Constitution des termes d'une loi promulguée peut être utilement contestée à l'occasion de l'examen de dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine».
C’est précisément cet examen-là que le Conseil Constitutionnel mène dans l’affaire des clauses de recommandation. Selon sa jurisprudence néo-calédonienne, c’est le principe même du L 912-1 qu’il examine.
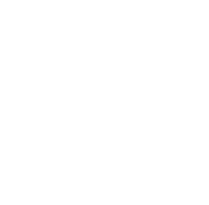 Courtage Network
Courtage Network